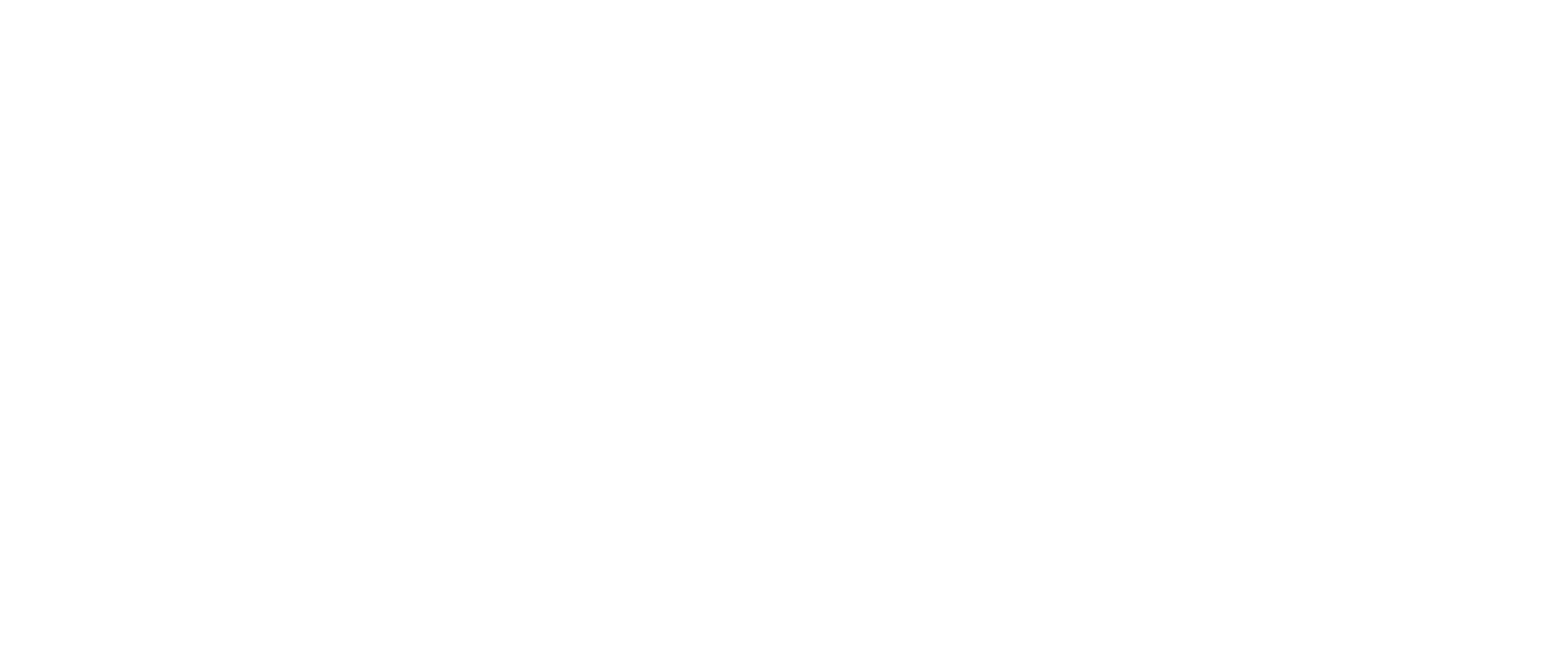LA TRIBUNE - Votre nouveau livre, « Jouer sa peau », a une dimension éthique plus affirmée que les précédents ?
NASSIM NICHOLAS TALEB - Oui, c'est ce que suggère la couverture, c'est l'emballage ! Mais le thème central dont je traite c'est l'asymétrie qui occupait déjà une place importante dans « Antifragile », mon précédent livre. Au fil de mon travail, je me suis aperçu que tout est fondé sur cette notion, en particulier l'éthique. Par exemple, si je gagne davantage que je ne perds, cela pose un problème d'asymétrie. Regardez le cas de Bob Rubin (ex-secrétaire au Trésor de Bill Clinton et ex-président de la banque Citigroup qu'il a quitté au bord de la faillite tout en empochant des dizaines de millions de dollars. NDLR), il a une option sur les gains et les bénéfices sans aucune obligation sur les pertes. Nos sociétés fonctionnent sur ces transferts de risques, ce qui pose un problème éthique, mais aussi pratique à plus long terme.
Outre l'asymétrie, la deuxième notion importante est celle d'échelle, l'asymétrie opère non seulement au niveau des individus, mais aussi des groupes, des sociétés. On doit tenir compte de cette dimension multi-scalaire. Ce qui m'a conduit à penser que la notion d'universalisme n'est que théorique. En pratique, elle est impossible à appliquer, la réalité est fractale.
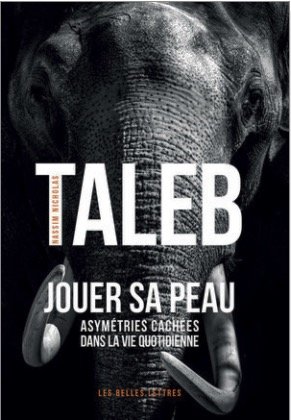
Autrement dit, celui qui prend les risques doit les assumer...
Oui, mais il faut nuancer. Lorsque le médecin soigne son patient, il attend en retour un gain matériel ou un avantage moral. Mais on tolère qu'il se trompe un peu, parce que la société a besoin de lui. La logique qui veut que celui qui prend les risques doit toujours en supporter les conséquences n'est pas applicable dans tous les cas. Historiquement, les médecins ont une obligation morale de soigner, c'est leur responsabilité, mais ils ne peuvent le faire que parce que leurs échecs ne leurs sont pas imputés.
Mais prenons un autre contexte. J'ai dédié ce livre à un ami, Ralph Nader. Grâce à ses campagnes, il a réussi dans les années 1960 à étendre la protection juridique aux consommateurs, ce qui permet d'attaquer une entreprise. Le fait de pouvoir faire reconnaître devant la justice qu'une entreprise vous a causé du tort, et la faire condamner est essentiel pour que le capitalisme marche. Une compagnie doit prendre des risques pour pouvoir faire du profit. Ce point de gouvernance est essentiel.
Mais le génie de Ralf Nader a consisté à obtenir de tels droits non par la régulation ou la protection de l'État, mais devant les tribunaux. Si une entreprise vous cause un préjudice, vous devez pouvoir exiger réparation. Elle a donc beaucoup à perdre à ne pas assurer correctement les services ou les produits qu'elle vend.
C'est la différence entre la loi et le contrat ?
Exactement. Et l'asymétrie, c'est précisément une question de contrat. La découverte de la notion de risque et l'étude des probabilités ne datent pas du 18e siècle. Cela a commencé avec le roi de Babylone Hammourabi (1810 av. J.-C-1750 av. J.-C). L'État ne vous disait pas comment vous deviez vivre, mais imposait une pénalité à quiconque nuisait à une autre personne.
Les gens étaient déjà sophistiqués au Moyen Âge. Je mentionne un livre de scolastique daté du XIIIe siècle, le « Traité des contrats » (*), de Pierre Jean de Olivi, où est décrite une société qui était fondée sur des contrats.
Nous aurions donc remplacé historiquement le contrat par la loi ?
En Europe, oui. Mais, dans l'Empire romain par exemple, le partage de risques était un principe commercial. Dans l'Antiquité, une loi à Rhodes stipulait que personne ne gagne si tout le monde perd. Si pour sauver un bateau et son équipage, on doit jeter par-dessus bord une cargaison, la perte doit être supportée par tous les acteurs, le vendeur, l'acheteur, le capitaine, le financier... Tout le monde assume sa part.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas ?
Non.
Prenons un exemple actuel, celui de la politique monétaire accommodante de la BCE présidée par Mario Draghi. Certains considèrent que le choix de maintenir des taux bas crée des risques qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour tous plus tard. Qu'en pensez-vous ?
Cela n'aura aucune conséquence, comme l'illustre le Bitcoin. Le succès des cryptomonnaies est précisément dû à ces politiques de manipulation des taux. Les décisions d'un « bureaucrate » comme Mario Draghi peuvent être bonnes comme néfastes, le problème est qu'il n'en assumera jamais les conséquences. Il pourra couler une retraite paisible. Généralement, les macro-décisions, à l'image des politiques monétaires, représentent d'importantes prises de risque. Les micro-décisions sont plus intéressantes, comme l'illustre le système politique fédéral de la Suisse, où le pouvoir réel de décision se trouve au niveau de la commune. À l'échelle micro, les erreurs sont rapidement visibles.
Il vaut donc mieux éviter de prendre des risques au niveau d'un État ?
Il y a deux méthodes face à la prise de risque. La première, « top-down », appliquée par nos dirigeants et leurs experts, assure qu'elle sait identifier les événements aléatoires pour s'en protéger. La deuxième, celle des contrats, préfère modifier les termes du contrat plutôt que d'établir des petites probabilités. Autrement dit, il vaut mieux avoir un bon avocat que 12 statisticiens. Par exemple, si vous souscrivez une assurance, on peut rajouter des clauses si il y a des doutes entre les deux parties. Cela semble trivial, mais la gestion des risques est la théorie qui se trouve à la base des contrats, et détermine les responsabilités. Aujourd'hui, nos dirigeants ne comprennent pas le principe de « risquer sa peau » car ils bénéficient de la protection de l'État. Ils adoptent une position d'arrogance épistémique en étant persuadés de connaître tous les risques. On l'a vu dans l'intervention en Libye. Hillary Clinton, en tant que secrétaire d'État, aurait dû être instruite de l'exemple irakien. Mais elle a décidé de le faire parce qu'elle n'en subissait aucune conséquence, contrairement aux populations locales. Plus on s'élève au niveau macro, et moins les gens deviennent responsables de leurs actes, c'est un phénomène caractéristique de nos États modernes.
C'est ce qui expliquerait, selon vous, l'élection de Donald Trump face à elle ?
Oui, mais pour comprendre cela, faisons un détour par la théologie. Originaire du Levant, et chrétien orthodoxe de rite grec, je me suis toujours demandé pourquoi Jésus doit être considéré à la fois comme Dieu et comme homme. La première fondation est « bottom-up » : l'homme devient Dieu, mais un Dieu ne souffre pas, car il ne prend aucun risque. Jésus lui au contraire a souffert, il a été crucifié. Pour la plupart des gens, quelqu'un qui a souffert est plus réel. Contrairement à Hillary Clinton, Donald Trump a connu des faillites, puis s'est refait et a gagné beaucoup d'argent, malgré ses erreurs. La deuxième explication relève d'une morale que les Européens ont des difficultés à comprendre. Aux yeux de l'Américain moyen, des personnages comme Hillary Clinton ou encore Barak Obama, qui s'est fait payer 65 millions de dollars de droit pour ses Mémoires, rentrent dans la fonction publique pour devenir riches, grâce à l'argent des contribuables. Trump lui ne doit pas sa richesse à cet argent public. Pour une partie des Américains, il peut les comprendre, car il est dans la vraie vie.
Et comment expliquez-vous la victoire d'Emmanuel Macron ?
C'est la même logique. Macron n'est pas entrepreneur, mais les Français ont préféré quelqu'un qui avait déjà travaillé dans sa vie plutôt qu'un professionnel de la politique. Rappelez-vous que par le passé, siégeaient à l'Assemblée nationale des commerçants, des médecins, des ouvriers, des avocats, des professions qui étaient représentatives de la société française et non des bureaucrates de la politique.
C'est cela le populisme, une certaine lassitude des gens face ce que vous qualifiez de « baratin » ?
Exactement. Ils préfèrent la pratique à la théorie, ce qui est moins beau, la réalité n'étant pas platonique. Il faut comprendre l'attitude populiste. Qui contrôle le discours dominant ? Le groupe de bureaucrates intellectuels qui ne risquent jamais leur peau, le cas typique en France étant Bernard-Henri Lévy. C'est d'ailleurs eux qui parlent de populisme. Mais ça change, notamment grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Trump a été élu contre le système politique américain sans contrôler le discours « mainstream ».
Dans votre livre, vous vous définissez comme libertarien, qu'entendez-vous exactement par ce terme méconnu en France ?
Je me réfère à Ron Paul, à qui j'ai également dédié mon livre, qui fut le candidat libertarien à la présidentielle de 2012 contre Barak Obama. Il a soulevé, selon moi, deux problèmes importants, l'un politique et l'autre d'échelle. Le premier est qu'aucun pouvoir ne doit s'imposer aux individus, en particulier celui de l'État. Cette idée est d'ailleurs partagée par une partie de la gauche et une partie de la droite. Paul n'est pas contre l'autorité, mais il juge que l'État fédéral ne doit pas s'occuper de vos affaires, qui doivent se régler au niveau de la municipalité où vous vivez. C'est du localisme. Le deuxième est le problème d'échelle. Les États-Unis ne sont pas une république, mais une confédération comme la Suisse. Comparer les statuts de Macron et de Trump n'a pas de sens. À mes yeux, il n'est pas incompatible de se définir républicain au niveau de l'Etat, mais cela dépend de sa taille, démocrate libertaire au niveau de la commune, et communiste pour la famille et les amis, ma communauté. C'est ce problème d'échelle que les gens ne comprennent pas.
En quoi est-ce un avantage ?
Parce que vous pouvez plus facilement interpeller un maire qu'un ministre. Le premier fait partie de la communauté, il doit rendre des comptes. Ce n'est pas un problème de démocratie, mais de gouvernance. Voyez comment la subsidiarité a été limitée dans la gouvernance de l'Union européenne. Supposez que je réside dans un État européen comme le Liechtenstein. Je n'ai pas envie que quelqu'un à Bruxelles détermine comment je dois vivre. Mais si vous êtes à Paris, vous acceptez que la maire détermine comment vous devez vivre même si Paris est plus grand que le Liechtenstein. La bonne gouvernance consiste à trouver la bonne échelle. Mon libertarianisme n'est pas sans règles.
Il est plus politique qu'économique ?
Oui, par exemple Ron Paul est favorable à ne pas limiter l'immigration au nom de la libre circulation des personnes, pour ma part, je préfère que les communautés fixent leurs règles. Libre à chacun d'intégrer la communauté qu'il désire, et d'en changer quand il veut. Si une communauté décide d'interdire l'importation d'ail chinois, elle en assume la responsabilité en préférant se priver d'une ressource moins chère que le produit cultivé localement. C'est leur choix. La mondialisation pose d'ailleurs un problème d'échelle. S'ouvrir à tous les produits favorise la logique du « winner take all », ce qui peut générer de l'instabilité. Les gens n'aiment pas qu'on leur impose un modèle standard sur lequel ils n'ont pas prise. Ils préfèrent avoir de la diversité localement et surtout pouvoir décider par eux-mêmes. En Suisse, par exemple, certaines communes ont interdit aux étrangers d'acheter des terrains chez eux. Ils voulaient éviter que le prix du foncier augmente, parce que des milliardaires saoudiens voulaient acquérir des appartements. Ils ont le droit de prendre une telle décision parce qu'il leur semble anormal que leurs enfants ne puissent pas acheter leur futur appartement et soient condamnés à partir. Cela n'a rien à voir avec une politique de gauche ou de droite, c'est un problème d'échelle. Il faut éviter l'uniformité telle qu'on la voit s'étendre à travers le monde.
Ce problème d'échelle touche jusqu'à la façon dont nous parlons, notre communication ?
Oui, pour illustrer ce point, je prendrai l'exemple d'une discussion entre deux Stoïciens, Diogène de Babylone et Antipatros de Sparte : est-il moral de vendre une marchandise à Rhodes en provenance d'Alexandrie sans dire que 5 bateaux d'une cargaison de blé vont arriver et faire s'effondrer les prix du blé. Entre traders, il est immoral de se piéger pour la bonne raison que l'on va être ostracisé par la communauté des traders au sein de laquelle doit être respectée une éthique. Si c'est un étranger à cette communauté, on n'est pas obligé de lui dire. Il y a des cercles différents d'éthique. Nombre de règles de morale sont universelles. Mais si je vois deux enfants se noyer dont l'un est mon fils, je dois d'abord sauver ce dernier. Je suis évidemment obligé de sauver les deux, mais je dois commencer par mon fils. Ce n'est pas un réflexe de tribalisme. Et cela ne peut pas marcher autrement.
De même, il y a des choses que l'on peut dire à certains et pas à d'autres ?
Oui, on ne peut pas être intégralement transparent au nom de l'éthique. Par exemple, je suis obligé de l'être envers un consommateur si je lui vends un produit défectueux, dois-je pour autant lui donner mes secrets de fabrication ? Évidemment non. Je regarde ces problèmes d'un point de vue multifractal, et à différentes échelles. À chaque niveau d'éthique correspond une certaine transparence. Ce que nous disons à nos proches n'a pas à être communiqué à tout le monde.
Cela va à rebours de nos sociétés qui veulent de plus en plus de transparence ?
Oui, mais elles se trompent en ne distinguant pas les échelles. Ce point a été étudié dans les travaux Elinor Ostrom sur les « biens communs » (les « commons »), qui lui ont valu un prix Nobel d'économie. Elle montre que le comportement moral d'un individu dans une communauté de 250 est impossible lorsque nous sommes 250.000. On retrouve notre problème d'asymétrie. Sur un plan éthique, la rationalité individuelle n'a rien à voir avec la rationalité collective. Et parfois, il faut beaucoup d'irrationalités individuelles pour avoir une rationalité au niveau collectif.
Cela veut-il dire qu'il y a deux niveaux de rationalité ?
Oui, il faut des fous dans une société, c'est-à-dire des gens qui travaillent contre leur propre intérêt. Ainsi, il est plus sécurisant d'être un fonctionnaire que de prendre des risques démesurés comme le font les entrepreneurs. Dans un cas, vous savez ce que vous allez faire dans les 40 prochaines années, pouvoir programmer vos vacances, etc. Dans l'autre cas, l'entrepreneur peut tout perdre ou travailler sans compter son temps. Mais c'est grâce à ce genre de folie individuelle qu'une société fonctionne. A contrario, la rationalité individuelle qui pousse au calcul égoïste peut devenir irrationnelle au niveau collectif, par exemple dans l'épuisement d'un bien commun. Pour que le collectif puisse perdurer, il faut violer les rationalités individuelles. Dans ce cas, la forme du groupe est plus efficiente, et c'est à ce niveau-là que l'on rencontre des comportements altruistes.
Vous dites dans votre livre que pour que la vie d'un individu ait du sens, il doit prendre des risques, tout en menant une vie raisonnable, en faisant preuve de prudence. N'est-ce pas contradictoire ?
Il y a deux réponses. Évidemment, on peut dire que la meilleure vie, c'est celle qui est la plus tranquille, et les individus y aspirent. Ma deuxième réponse s'inspire d'Aristote. Selon lui, la prudence est la plus grande des vertus, mais le courage est une vertu essentielle. Et il ajoute que les vertus n'étant pas contradictoires, si vous en possédez une vous devez avoir les autres. Pour répondre à votre question, il faut revenir au problème d'échelle : il faut être prudent au niveau du collectif et courageux au niveau individuel pour favoriser le collectif. Ma propre vie représente quelques dizaines d'années, alors que l'humanité, j'espère, a une durée de vie infinie ou au moins de plusieurs millions d'années.
Propos recueillis par Robert Jules
(*) Publié aux éditions Les Belles Lettres.
Nassim Nicholas Taleb "Jouer sa peau", éditions Les Belles Lettres, 384 pages, 24,90 euros.